la crise décortiquée

Surveillez quatre reportages intitulés « Meltdown » qu’on peut voir sur Internet. Même s’ils sont destinés au grand public, ils tracent un portrait saisissant de la crise et de ses conséquences économiques et sociales.
PLUS DE CRISE EN SUIVANT :
La série est diffusée par la CBC. Elle donne la parole à différents acteurs de la crise, experts, banquiers, ministres des Finances et journalistes. Il est impossible d’en décrocher une fois qu’on a pesé sur le bouton « Play ».
Le premier reportage met la table. En septembre 2008, GM, la plus grande compagnie du monde, fait faillite. Suit la plus importante faillite bancaire, Washington Mutual. Puis survient ce que le reportage appelle l’arrêt cardiaque de la finance mondiale : la déconfiture de Lehman Brothers. La plus grande faillite de tous les temps.
La série s’attarde ensuite sur l’Islande, probablement le pays le plus durement touché par la crise financière. On y voit les Islandais, un peuple pacifique, expérimenter la désobéissance civile. Des grand-mères qui tapent sur les boucliers de la police anti-émeutes, qui protègent le Parlement. Le Premier ministre dont la voiture est bombardée de déchets et d’œufs pourris le lendemain d’un diagnostic de cancer. Et un chanteur qui mène la charge contre un gouvernement qui finit par démissionner : « Les Islandais doivent maintenant payer le prix d’une expérimentation qui n’a profité qu’à une poignée d’individus », commente le nouveau ministre des Finances. Au moins, les Islandais ont le sens de l’entraide et des programmes sociaux bien établis.
Puis le reportage se déplace en Californie. On y découvre des villages de tentes de sans-abri. Ils sont des dizaines, à Sacramento, la ville qui fut la plus riche des États-Unis il y a… trois ans. Les tentes se dressent au même endroit que celles des sans-abri de la crise de 1929, comme le révèle les films d’époque.Mais, aujourd’hui, les enfants des sans-abri ont des écoles bien à eux, comme ce fils d’un retraité de GM, qui se déplace en… vélo. Certains enfants cachent de la nourriture distribuée à l’école, pour la rapporter à leurs parents affamés. Il y a 1,5 million d’enfants sans-abri aux États-Unis.
Puis, c’est au tour des travailleurs de la GM de Windsor, Ontario, à goûter à la médecine de crise : leur usine, où ils bénéficiaient d’un emploi à vie, de père en fils, ferme ses portes. Un peu plus loin, les travailleurs d’un manufacturier de pièces occupent leur usine, lorsqu’ils réalisent que le siège social veut la démanteler de nuit, sans payer les salaires en retard.
La série s’attarde aux effets de la crise en Espagne, à Dubaï, en Chine et à Wall Street. Partout des tragédies pour les gens ordinaires. Puis elle tente d’en décortiquer les causes.
Le ton ne laisse aucun doute : dès les premières minutes, on parle du CEO renégat qui a failli mettre la finance mondiale à genoux, car personne ne connaissait l’ampleur de ce casino qu’était devenu AIG. On décrit aussi le rôle du Secrétaire au Trésor, Henry Paulson, qui a renfloué ses vieux potes, dans ce qui est décrit comme le plus imposant chèque d’aide sociale de l’histoire.
Paulson n’y va pas de main morte en réclamant une intervention décisive du président Bush : « Ce qui arrive au système financier est l’équivalent d’une guerre et ça va nous prendre des mesures de guerre. Sinon, ce sera pire que la Grande Dépression des années 1930. » Certains affirment même que Paulson fut, pendant quelques mois, le véritable président des États-Unis!
Le dernier volet expose le coût de la crise et qui en paie le prix : les contribuables.
La série s’attarde sur le rôle des financiers de haut niveau qui ont passé au travers de la crise : certaines descriptions sont loin d’être flatteuses.
Les enquêtes révèlent désormais non seulement les faiblesses du système mais aussi des fraudes à grande échelle. En bout de ligne, alors que des millions de contribuables paient pour les pots cassés, que les gens perdent leurs emplois et leurs maisons, que l’économie demeure fragile, personne, à ce jour, n’a été poursuivi ou tenu responsable pour ce désastre.
D’autant plus qu’une crise semblable peut se reproduire à tout moment…
source F&I SEP10
EN COMPLEMENTS INDISPENSABLES : Triple A dans l’escroquerie en bandes organisées
La crise financière semble être survenue du fait de ce que les financiers appellent les produits exotiques. Pourtant il existe une centaine d’autres produits sur les marchés qui auraient pu remplacer avantageusement ces placements aussi toxiques qu’exotiques ? Comment peut-on élucider cet étrange phénomène du marketing ?
Il faut savoir en effet que de très gros investisseurs (fonds de pension, fonds souverains du Golfe ou de Chine, riches entrepreneurs, etc.) disposaient de beaucoup de liquidités à placer en 2000. Comme ils manquaient de confiance dans les marchés d’action depuis l’explosion de la bulle Internet, ils voulaient investir dans des sociétés et des titres particulièrement sûrs (qualité dite « AAA ») et surtout plus rémunérateurs que les bons du Trésor américains… Parfois même, ils avaient besoin de se couvrir contre les risques financiers afférents aux nouveaux types d’investissements qu’ils faisaient. L’industrie financière s’est alors généreusement mise à l’œuvre pour répondre à la demande de ces investisseurs en s’ingéniant à créer des produits sur mesure : mais de quoi se composent t-ils au juste ?
Des entités financières ont été créées pour vendre un produit financier spécial consistant en un portefeuille de titres, sous la forme d’obligations, en s’arrangeant pour que ce portefeuille apparaisse de bien meilleure qualité et rémunérateur que chacun des titres le composant. C’est ainsi que le titre représentant ce portefeuille s’est retrouvé gratifié du fameux triple A tant recherché par les agences de notation, Moody’s en tête, alors qu’il s’appuyait naturellement sur des modèles de risques mathématiques un peu optimistes.
Imaginons maintenant que les prix de l’immobilier se mettent à monter mais qu’il faille absolument que tous les pauvres aient accès à la propriété en vertu de l’American Dream et que grâce aux diverses incitations publiques massives, ils puissent acquérir leur maison… L’industrie financière a alors trouvé le carburant pour alimenter ces nouvelles machines infernales : les prêts hypothécaires bancaires transformés en obligations fictives, le tout hébergé dans des entités tout aussi fictives, montage complexe et kafkaïen pour les uns, sirop d’érable pour les autres, à déguster aux Bermudes… En parallèle, jamais à court d’imagination, l’industrie financière a créé son propre instrument de destruction massive : l’assurance crédit contre le défaut de paiement de ces portefeuilles spéciaux au cas où les prêts hypothécaires les composant ne seraient pas remboursés.
Ce qui est sûr, c’est que, depuis fin 2006, ces montages étaient devenus des châteaux de sable car les prix de l’immobilier américain se sont mis à baisser alors que toute la mécanique était basée sur une croissance stable et exponentielle, protection ultime de ces prêts hypothécaires. Ainsi, si un emprunteur ne pouvait pas rembourser, la banque pouvait toujours saisir et revendre le bien avec bénéfice. Mais alors que s’est-il passé ?
L’OPÉRATION ÉTAIT BIEN FICELÉE
Comme toute machine infernale, elle s’est emballée et les fabricants de ces portefeuilles spéciaux se sont dépêchés de transférer le risque à des investisseurs naïfs avant que le cataclysme de la baisse des prix immobiliers n’emporte tout. On crée à tout va de nouvelles entités fictives qui hébergent des prêts hypothécaires « subprime » à hauts risques, en les combinant à une obligation représentative du pool de crédit, qui elle, comme par hasard est très saine et triple A. En parallèle, les banques s’assurent contre les risques de faillite de ces entités grâce aux assurances crédit mentionnées plus haut, entités qu’elles n’hésitent pas à vendre comme particulièrement sûres ! L’opération était bien ficelée : non seulement les banques encaissaient de grosses commissions pour la fabrication de ces produits financiers, mais si jamais elles défaillaient, elles touchaient également l’argent de l’assurance ! Ainsi, les souscripteurs de ces produits aussi magiques qu’hypothétiques, clients des banques émettrices, encaissaient les hauts rendements promis par l’entité fictive censée être sûre, mais aussi une partie des remboursements en cas de défaillance.
C’est ainsi que Goldman Sachs a gagné beaucoup d’argent et qu’un patron de hedge fund, John Paulson, a gagné en primes exceptionnelles personnelles un milliard de dollars en 2007 sur ce type d’opérations. Malheureusement, du fait de la multiplicité des acteurs opérant autour de ces entités fictives, il est bien difficile de mettre en prison un acteur particulier. Bref, on gagne à tous les coups et sans risques ! C’est comme si votre voisin pouvait s’assurer contre l’incendie de votre maison et, en cas de sinistre, toucher le remboursement au même titre que vous. Le cierge pour que la maison brûle ne suffit pas et la tentation d’aider le destin… Allons plus loin dans l’analogie : Goldman Sachs et bien d’autres ont fabriqué des maisons en bois d’allumettes (les entités fictives appuyées sur les crédits hypothécaires subprime) et les ont repeintes en bois de chêne (notation triple AAA), puis vendus comme très solides à des propriétaires grands fumeurs qui avaient une forte probabilité, et on le savait, de mettre le feu à leur maison. En parallèle, Goldman Sachs et tous les autres ont bien sûr pris des assurances anti-incendie sur ces habitations… Le problème reste néanmoins intact ! Les pompiers ont bien du mal à éteindre l’incendie qui s’est propagé à l’échelle mondiale.
Pascal de Lima, économiste en chef Altran Financial Services, et Jean-Luc Strauss, directeur de la stratégie Altran Financial Services /LE Monde sep10
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Le casse du siècle continue : Banksters / Le directeur de HSBC part avec un parachute doré de 21 millions
D’habitude fière de sa solidité, même pendant la crise financière, HSBC a été sérieusement secouée ces dernières semaines par le remaniement de sa direction. Après une foire d’empoigne, qui s’est jouée en public via des fuites organisées dans la presse britannique, la plus grande banque mondiale – hors Chine – s’est choisi un nouveau président et un nouveau directeur général vendredi soir.
Le premier sera Douglas Flint, jusqu’à présent directeur financier; le second sera Stuart Gulliver, l’actuel directeur de la banque d’investissement. Il remplacera au 1er janvier prochain Michael Geoghegan, l’actuel directeur général qui espérait obtenir la présidence, mais a finalement été forcé à la démission. Au passage, ce dernier part avec un «parachute doré», que le Sunday Telegraph calcule à 36 millions de livres (56 millions de francs suisses).
La réalité, a indiqué lundi HSBC, est un peu moins impressionnante, mais reste substantielle: autour de 13,6 millions de livres (21,1 millions de francs). Elle comprend une indemnisation de départ de 2,2 millions de francs, 9,6 millions de francs en actions accumulées depuis des années, 2,8 millions de bonus de long terme et 6,5 millions de bonus de court terme.
Outre cette polémique, la controverse a surtout porté sur la façon dont s’est passée la succession. Stephen Green, le président de HSBC, a provoqué la panique en acceptant le 7 septembre le poste de ministre britannique du Commerce (effectif au 1er janvier prochain). Michael Geoghegan, le directeur général, espérait alors faire valoir la tradition de HSBC de promouvoir les directeurs généraux à la présidence. Mais il a fait face au code de bonne gouvernance britannique, qui recommande que le président soit quelqu’un d’extérieur, qui n’ait pas été le directeur général du groupe. Dans cette logique, John Thornton, ancien de Goldman Sachs et membre non exécutif du conseil d’administration de HSBC depuis 2008, était le favori pour prendre la présidence.
HSBC réplique que sa complexité nécessite de choisir quelqu’un en interne, qui connaisse bien l’entreprise. Le directeur financier représentait donc un compromis: tout en étant quelqu’un d’interne, cela cassait l’impression que le directeur général est systématiquement promu à la présidence.
La tête de Michael Geoghegan a donc roulé sur l’autel de la bonne gouvernance britannique. Quant à John Thornton, se voyant doublé pour la présidence, il a fait savoir ce lundi – toujours par presse interposée – qu’il n’allait probablement pas se représenter l’année prochaine pour rester au conseil d’administration.
Par Eric Albert, Londres le temps sep10
Catégories :Art de la guerre monétaire et économique, Au coeur de la création de richesse : l'Entreprise, Cycle Economique et Financier, Emploi, formation, qualification, salaire, Etats-Unis, Europe, Gestion du risque, Titrisation, Produits Structurés, Fonds à formules...., L'Etat dans tous ses états, ses impots et Nous, Le Monde, Le Temps, Mon Banquier est Central

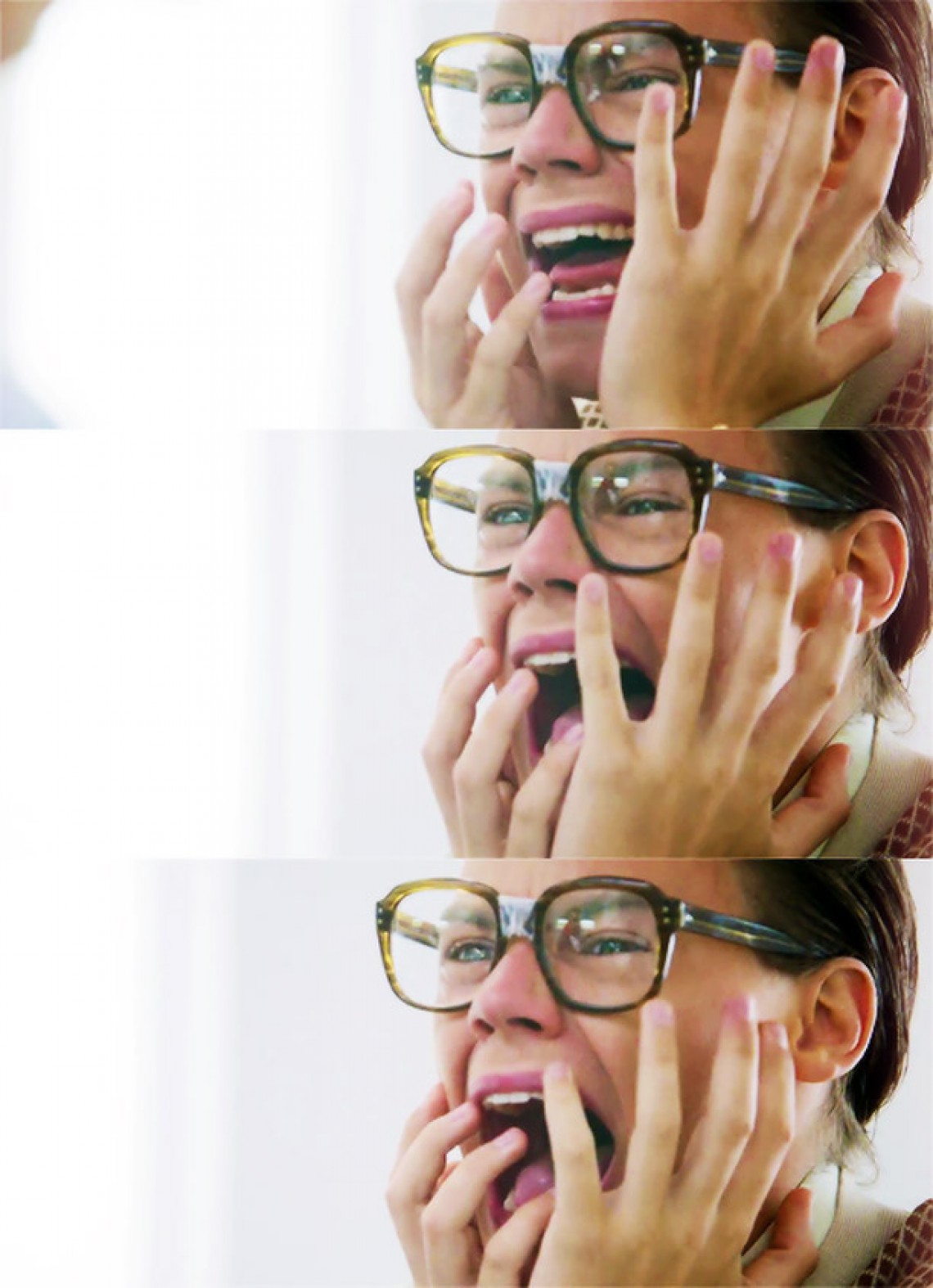









 RSS - Articles
RSS - Articles NI PUB, NI SPONSOR, NI SUBVENTION, SEULEMENT VOUS ET NOUS....SOUTENEZ CE BLOG FAITES UN DON
NI PUB, NI SPONSOR, NI SUBVENTION, SEULEMENT VOUS ET NOUS....SOUTENEZ CE BLOG FAITES UN DON
















1 réponse »