Ce diptyque ne cherche ni à convaincre ni à rassurer.
Il constate.
Nous sommes entrés dans un moment où la souveraineté cesse d’être un mot confortable pour redevenir une épreuve de réalité. Là où, pendant des décennies, l’Europe a substitué la morale à la puissance, la procédure à la décision, l’alignement à la stratégie, le réel revient réclamer des comptes. Brutalement. Sans préavis.
Le premier texte pose le diagnostic général : la fin des illusions géopolitiques. Il décrit un continent qui parle de guerre après avoir désarmé son industrie, son énergie, sa démographie et sa volonté politique. Une Europe qui confond règles et souveraineté, et découvre trop tard que les règles n’existent que portées par la force.
Le second texte incarne cette rupture à travers une figure devenue scandaleuse précisément parce qu’elle refuse le mensonge collectif. Non comme modèle, mais comme révélateur. Quand un homme qui rappelle des évidences passe pour un danger, c’est que le décor a déjà cédé.
Pris ensemble, ces deux textes racontent la même histoire : celle d’un système qui se survit par la narration, et d’un réel qui ne demande plus la permission d’entrer en scène.
Ce diptyque n’est pas un manifeste.
C’est une mise en demeure.
La suite appartient à ceux qui accepteront enfin de regarder le monde tel qu’il est — et non tel qu’on leur a appris à le réciter.

Souveraineté ou simulacre
La fin des illusions géopolitiques
Il y a des moments où l’Histoire cesse de chuchoter.
Elle ne prévient plus.
Elle impose.
Nous vivons précisément cet instant : celui où la souveraineté, longtemps dissoute dans le jargon, les normes, les ONG et les sommets feutrés, revient comme une exigence brutale. Non pas une idée. Une condition de survie.
Pendant trois décennies, on nous a vendu un monde pacifié par le droit, régulé par l’expertise, adouci par la gouvernance. En réalité, nous avons assisté à une dépolitisation organisée, à une neutralisation volontaire de la puissance, surtout en Europe. Le réel, lui, n’a jamais signé ce contrat.
Aujourd’hui, le décor brûle.

La fin du mensonge global
Ce qui s’effondre sous nos yeux n’est pas un ordre international, mais une fiction morale : celle d’un monde gouverné par des règles universelles indépendantes de la force. Cette fable n’a toujours fonctionné qu’à sens unique. Elle était tolérable tant que les vainqueurs d’hier y trouvaient leur compte. Elle devient caduque dès que les rapports de puissance se déplacent.
Le retour de Donald Trump n’est pas une rupture civilisationnelle ; c’est une déclaration de franchise. Plus de sermons. Plus de rhétorique humanitaire. Le langage est réduit à sa forme la plus simple : intérêt, levier, résultat. Ce n’est pas plus immoral qu’avant — c’est simplement moins hypocrite.
Ceux qui s’indignent aujourd’hui ne découvrent pas la brutalité du monde. Ils découvrent qu’elle ne se cache plus.
Donald Trump ne révèle pas une vérité supérieure ; il retire le voile. Il ne détruit pas l’hypocrisie libérale : il la remplace par un transactionnalisme frontal. C’est moins une révolution qu’un changement de rhétorique. La puissance américaine n’a pas attendu 2025 pour agir par intérêt. Elle a seulement cessé de se raconter des histoires.
Trump ne respecte pas la force : il respecte l’utilité. Et ce qui n’est pas utile est négociable, jetable, pressurable.
L’Europe : laboratoire du renoncement
Face à ce retour du réel, l’Europe apparaît nue.
Désarmée matériellement.
Désarmée intellectuellement.
Désarmée politiquement.
Elle a confondu droit et morale, règles et vertu, procédure et souveraineté. Elle a externalisé son énergie, sous-traité sa défense, culpabilisé sa démographie, bureaucratisé sa volonté. Le résultat est mécanique : elle ne pèse plus.
Le symbole parfait de cette abdication est incarné par Ursula von der Leyen, figure du pouvoir sans peuple, de l’autorité sans enracinement, de la décision sans responsabilité. Tout y est : posture morale, ton professoral, et incapacité totale à produire de la puissance réelle.
L’Europe ne subit pas la géopolitique.
Elle refuse d’y participer.
L’Europe n’est pas condamnée par la géopolitique ; elle l’est par son refus d’assumer la puissance. Abandon industriel, dépendance énergétique, confusion normative : la défaite est auto-infligée. La réponse n’est ni l’alignement servile ni l’aventure impériale eurasienne, mais la reconstruction des capacités (nucléaire, défense, industrie lourde, données). Sans cela, elle restera le terrain de jeu des autres.
L’exception permanente : l’arme des faibles
Dans ce nouveau cycle, beaucoup brandissent l’argument de l’urgence : guerre, sanctions, chaos, état d’exception. Grave erreur. Faire de l’urgence un régime, c’est admettre que l’on ne sait gouverner que dans la crise. La souveraineté véritable n’est pas hystérique. Elle est structurelle.
Un État souverain ne menace pas en permanence.
Il dispose.
Il dispose d’une industrie.
Il dispose d’une énergie fiable.
Il dispose de frontières opérantes.
Il dispose d’une continuité historique.
Tout le reste relève du théâtre.
La souveraineté authentique n’est pas une suspension du droit ; elle est la capacité de produire un ordre durable sans se réfugier dans l’urgence permanente. Faire de l’exception la norme, c’est avouer l’impuissance à gouverner autrement que par la crise.
Le droit international n’est pas “mort” ; il est sélectivement piétiné par ceux qui n’acceptent de règles que lorsqu’elles les servent. Le proclamer caduc, c’est se donner un alibi philosophique pour agir sans responsabilité. TS2F appelle cela un aveu, pas une vision.
L’énergie, la frontière, la matière : le retour du concret
Les discours moraux se dissipent toujours devant trois réalités irréductibles :
- l’énergie,
- la frontière,
- la matière.
Celui qui ne maîtrise pas son énergie est dépendant.
Celui qui ne contrôle pas ses frontières est perméable.
Celui qui a renoncé à produire est colonisable.
La souveraineté n’est pas une déclaration. C’est une chaîne de valeur complète. Ceux qui l’ont compris agissent. Ceux qui ne l’ont pas compris tweetent.
L’énergie comme instrument de strangulation est réelle. Mais l’argument théologique (“don de Dieu”) est une fausse transcendance. Le XXIᵉ siècle arbitre par la technologie, pas par l’invocation. Qui maîtrise la chaîne complète — extraction, transformation, stockage, réseaux, nucléaire de nouvelle génération — détient la marge de manœuvre. Le reste n’est que posture.
Le nihilisme comme fausse lucidité
La tentation la plus dangereuse de notre époque est de transformer la brutalité du monde en doctrine morale inversée : puisque tout est violence, alors tout serait permis. Puisque les règles sont bafouées, alors il n’y aurait plus de limites.
C’est faux.
Et c’est suicidaire.
Un monde sans limites ne produit pas des empires durables. Il produit des champs de ruines. La puissance sans retenue n’est pas souveraine : elle est consommatrice d’elle-même.
Theodor W. Adorno interrogeait la possibilité de la poésie après Auschwitz pour sauver l’humain, pas pour l’abolir. Transformer la destruction en doctrine revient à institutionnaliser l’inhumain. TS2F récuse ce chantage : la survie d’un État ne justifie pas l’effacement de toute limite. Sans limites, il n’y a plus d’État — seulement des cycles de ruines.
TS2F : souveraineté architecturale, pas incantatoire
La souveraineté du XXIᵉ siècle n’est ni impériale ni humanitaire.
Elle est architecturale.
Elle repose sur :
- une base industrielle réelle,
- une autonomie énergétique assumée (nucléaire compris),
- une capacité militaire crédible,
- une cohésion démographique et culturelle minimale,
- un État stratège, non moralisateur.
Sans cela, il n’y a que des slogans.
Et les slogans ne protègent rien.
La “Power Politics” brandie comme vérité ultime est une régression conceptuelle. La souveraineté moderne ne se décrète pas dans l’exception ; elle se construit dans la durée. Elle exige des frontières fonctionnelles, des industries souveraines, une énergie maîtrisée, une monnaie crédible, et un État capable de décider sans hystérie.
Le monde n’a pas besoin de nouveaux empires bavards.
Il a besoin d’États capables, responsables et limités.
Tout le reste n’est qu’enfumage.
Dire que les États sans bouclier nucléaire sont condamnés, c’est confondre capacité militaire et capacité politique. L’histoire récente montre l’inverse : la résilience se construit par la diversification, l’alliage industriel, la maîtrise des flux critiques. La souveraineté n’est plus binaire ; elle est composite. Ceux qui la réduisent au missile signent leur dépendance future.
Conclusion : la fin de l’enfumage
Le cycle qui s’ouvre n’est pas celui de la paix universelle ni celui de l’Empire total. C’est celui de la désillusion. Les peuples redécouvrent que le monde est tragique, que la puissance existe, et que la souveraineté ne se délègue pas.
Ceux qui s’y préparent survivront.
Ceux qui continuent à réciter des mantras disparaîtront.
Le brouillard se dissipe.
Les mots creux brûlent.
La souveraineté redevient ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être :
une condition de réalité.
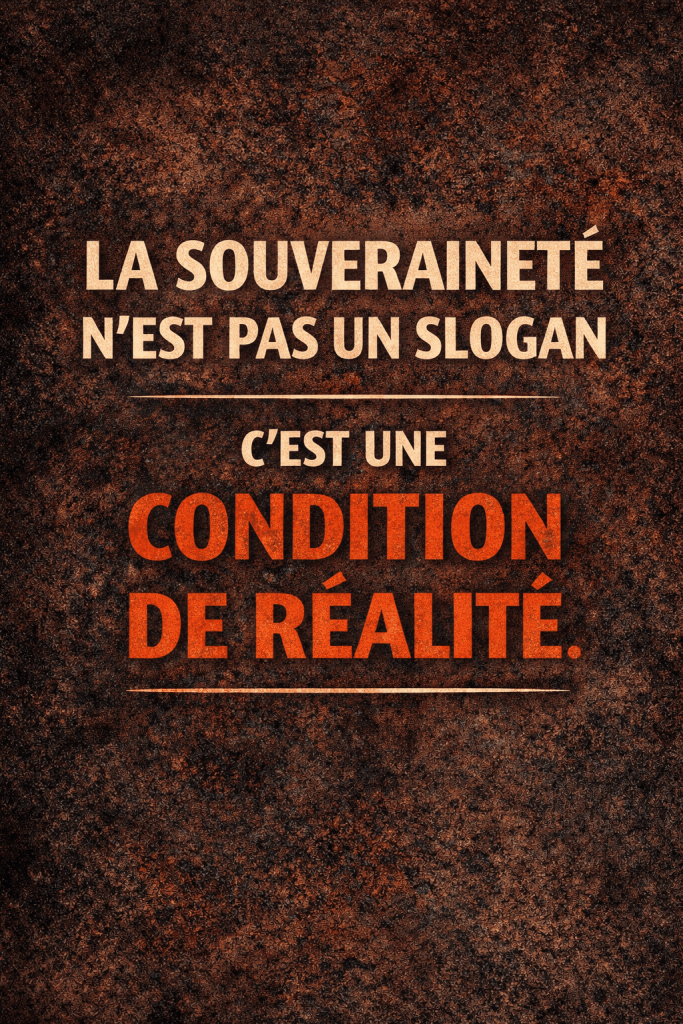
L’étrange Monsieur Viktor
Orbán seul contre tous, ou le réalisme comme scandale
Il est devenu l’homme dont on se détourne dans les couloirs, celui que l’on siffle dans les communiqués, que l’on excommunie à coups de résolutions. Viktor Orbán n’est pas isolé parce qu’il ment. Il l’est parce qu’il dit. Et surtout parce qu’il dit tout haut ce que l’appareil européen sait déjà, mais refuse d’assumer.
Son propos ne relève ni de la provocation gratuite ni de l’anti-occidentalisme de posture. Il relève d’un réalisme froid : l’Europe s’est engagée dans une logique de guerre sans disposer des moyens, sans autonomie stratégique, sans consensus politique durable. On ne mène pas une guerre avec des incantations morales, des communiqués et des dépendances énergétiques. On ne tient pas un front quand on a désarmé l’industrie, saboté l’énergie, culpabilisé la démographie, externalisé la sécurité — et confié jusqu’à la narration à d’autres.
Orbán ne choque pas : il réveille.
Il rappelle une évidence que l’idéologie tente d’anesthésier : l’alignement sans puissance n’offre aucune garantie — seulement des factures.

Le scandale Orbán : refuser le théâtre
L’UE préfère la narration à la stratégie. Elle confond morale et souveraineté, procédure et décision. Résultat : une Europe qui parle de guerre alors qu’elle a renoncé aux conditions matérielles de la guerre — et aux conditions politiques de la paix.
Ce n’est pas une trahison qu’Orbán désigne. C’est une irresponsabilité collective. Et si ce discours est marginalisé, caricaturé, diabolisé, c’est précisément parce qu’il dévoile la mise en scène. Une Europe en guerre sans puissance propre devient un théâtre d’opérations, pas un acteur. Voilà la fissure. Voilà le tabou.
Parallèle : L’Étrange Monsieur Victor — le réel contre la façade
Le malaise Orbán rappelle un vieux film français : L’Étrange Monsieur Victor. Chez Grémillon, le respectable notable n’est qu’un masque ; la vérité rôde derrière la façade, et finit toujours par revenir réclamer son dû. Le scandale n’est pas le crime : c’est la dissimulation. Le trouble n’est pas l’homme : c’est le décor qui se fissure.
Orbán joue ce rôle-là dans l’Europe actuelle. Non pas le provocateur, mais le révélateur. Il n’apporte pas le chaos ; il retire le maquillage. Et ce que l’on voit derrière — dépendance, faiblesse industrielle, fragilité sociale — est insupportable à ceux qui vivent de la fiction.
L’Étrange Monsieur Victor (tourné en 1937, sorti en 1938) appartient à ce moment très particulier de l’histoire européenne :
un avant-guerre saturé de mensonges, de faux-semblants moraux, de respectabilité de façade — tandis que la catastrophe est déjà là, souterraine, inexorable.
Chez Jean Grémillon, tout est dit avant même que la guerre n’éclate :
- une société hypocrite,
- des notables lâches,
- une morale officielle qui sert de paravent,
- et un homme solitaire, ambigu, marginalisé, qui voit clair mais dérange.
Nous sommes exactement dans cette configuration aujourd’hui.
L’Ukraine joue le rôle de l’Espagne de 1936 :
un théâtre avancé, une guerre par procuration, un champ d’expérimentation idéologique et militaire.
Et l’Europe, comme en 1937, parle beaucoup de valeurs tout en étant structurellement incapable d’assumer une guerre longue, faute d’industrie, d’énergie, de cohésion et de volonté populaire.
Dans ce contexte, Viktor Orbán occupe la place de « l’étrange monsieur » :
- isolé,
- caricaturé,
- diabolisé,
non parce qu’il serait fou ou traître, mais parce qu’il refuse la narration dominante.
Comme le personnage de Grémillon, Orbán ne correspond pas au récit moral attendu.
Il ne joue pas le rôle assigné.
Il ne récite pas la liturgie guerrière européenne.
Et comme en 1937, ceux qui parlent le plus fort de morale sont souvent ceux qui préparent le pire sans en avoir le courage, pendant que ceux qui avertissent sont traités d’“infréquentables”.
La leçon de Grémillon est cruelle et prophétique :
ce ne sont pas les monstres déclarés qui annoncent la guerre,
mais les sociétés qui refusent de voir ce qu’elles sont devenues.
1937 n’était pas encore la guerre.
Mais tout y était déjà.
2026 ressemble dangereusement à ce moment-là.
Et comme toujours,
ceux qui disent non avant la catastrophe
passent pour étranges
— jusqu’à ce que l’Histoire leur donne raison, trop tard.
Réalisme n’est pas pacifisme
Dire que l’Europe n’a pas les moyens n’est pas prêcher la reddition. C’est refuser le mensonge. La souveraineté n’est pas une posture morale ; c’est une architecture. Sans énergie fiable, sans base productive, sans continuité démographique, sans décision politique, la morale n’est qu’un luxe rhétorique.
Orbán n’annonce pas la fin de l’Europe. Il avertit : une Europe en guerre sans puissance devient un objet. Et ce n’est pas son discours qui inquiète Washington comme Ottawa ; c’est ce qu’il met à nu.
Conclusion : l’homme qui dérange parce qu’il compte
On peut conspuer Orbán. On peut le caricaturer. On peut le marginaliser. Mais on ne peut pas réfuter le diagnostic sans changer le réel. Tant que l’Europe préférera l’alignement à la souveraineté, la narration à la stratégie, l’indignation à la décision, l’étrange Monsieur Viktor restera seul — et terriblement lucide.
Dans les périodes de bascule, ceux qui parlent vrai passent toujours pour suspects.
Jusqu’au jour où la façade cède.
Marquis de Sade – Final Fog est un contrepoint terminal idéal pour ce diptyque : froid, urbain, sans catharsis.
Final Fog ne conclut pas : il enveloppe.
Une brume épaisse, sans héroïsme, où les certitudes s’éteignent une à une. La bande-son d’un continent qui découvre que la morale ne remplace ni l’énergie, ni l’industrie, ni la décision.
Ce choix musical dit l’essentiel :
pas d’apothéose,
pas de consolation,
pas de futur prémâché.
Seulement la lucidité froide d’un monde qui redevient tragique.
La souveraineté n’y est plus un slogan — mais une ligne de survie.
La musique de Marquis de Sade porte en elle cette froideur post-catastrophe qui fait immédiatement écho à Nuit et Brouillard. Non pas l’horreur montrée, mais l’après : le monde vidé de ses illusions, la normalité revenue avec un goût de cendre, la mécanique administrative qui continue comme si.
Là où Theodor W. Adorno a figé l’intuition dans une formule devenue dogme (« écrire de la poésie après Auschwitz… »), Maurice G. Dantec est allé plus loin — parce qu’il a refusé la paralysie morale.
Dantec n’a pas sanctuarisé Auschwitz comme un point final. Il l’a pris comme point de départ tragique : non pas l’interdiction d’écrire, mais l’obligation d’écrire autrement, contre, après la chute.
C’est exactement ce que suggère Final Fog.
Pas de pathos.
Pas de rédemption.
Une brume terminale où l’on avance sans promesse, avec pour seule boussole ce qui tient encore quand tout a été falsifié.
Adorno dit : attention.
Dantec dit : avance quand même — mais armé.
Et c’est là que la musique de Marquis de Sade rejoint le diptyque : elle ne commémore pas, elle diagnostique. Elle dit que l’horreur absolue n’a pas accouché d’un monde plus sage, mais d’un monde administré, moraliste, procédural — capable de refaire le pire sous des formes propres.
Après Auschwitz, il n’y a pas le silence.
Il y a la lucidité sans anesthésie.
Et Final Fog n’est pas une élégie.
C’est la bande-son de cet après —
là où la souveraineté n’est plus un idéal,
mais une condition de survie morale.
Quand la brume tombe, il ne reste que ce qui tient sans récit.

Réaliser un don ponctuel
Réaliser un don mensuel
Réaliser un don annuel
Choisir un montant
Ou saisissez un montant personnalisé :
Votre contribution est appréciée.
Votre contribution est appréciée.
Votre contribution est appréciée.
Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuelLES MESSAGES SONT TOUS LUS. UNE REPONSE N-EST PAS SYSTEMATIQUE
En savoir plus sur Le blog A Lupus un regard hagard sur Lécocomics et ses finances
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.
Catégories :Collapsologie, Etats-Unis, Europe, Géopolitique Friction, Hongrie















 NI PUB, NI SPONSOR, NI SUBVENTION, SEULEMENT VOUS ET NOUS....SOUTENEZ CE BLOG FAITES UN DON
NI PUB, NI SPONSOR, NI SUBVENTION, SEULEMENT VOUS ET NOUS....SOUTENEZ CE BLOG FAITES UN DON



Souveraineté ou simulacre.
L’Europe au pied du réel.
Ce diptyque ne polémique pas. Il classe.
D’un côté, la fin des illusions géopolitiques : morale sans puissance, procédures sans décision, alignement sans garantie. De l’autre, une figure qui dérange parce qu’elle refuse le mensonge collectif.
L’Europe parle de guerre après avoir désarmé son industrie, son énergie, sa démographie et sa souveraineté. Elle découvre que les règles n’existent que portées par la force — et que la force ne se décrète pas.
Quand dire des évidences devient scandaleux, c’est que le décor a déjà cédé.
Ce diptyque met à nu une vérité simple : la souveraineté n’est pas un récit, c’est une architecture.
👉 À lire sur Le Blog à Lupus.
Sans posture. Sans fard.
#Souverainete #Europe #Geopolitique #Reel #TS2F #BlogALupus
J’aimeAimé par 1 personne