La politique du «mais-non-voyons» Par Beat Kappeler

A Bruxelles, les politiciens manquent de sérieux: ils ficellent des paquets d’aide faramineux aux Etats membres en difficulté après avoir promis de ne pas le faire. Ils sapent ainsi la confiance des investisseurs, et mènent l’Europe à une crise sans nom.
Un peu de sérieux, Messieurs les politiciens européens, s’il vous plaît! Que d’affirmations n’avait-on pas entendues depuis une année, des affirmations démenties par les faits quelques jours plus tard: non, la Grèce n’aura pas besoin d’aide – c’était il y a une année, et un mois plus tard le paquet d’aide était décidé. Non, l’Irlande est un cas à part, pas besoin de sauvetage, merci. Un peu plus tard, un énorme paquet d’aide était ficelé. Non, le Portugal s’en sortira tout seul, mais le lendemain, c’est-à-dire cette semaine, il demandait de l’aide.
PLUS DE POLITOCARD EN SUIVANT :
Et le manège continue maintenant avec l’éventualité d’une banqueroute, une restructuration des dettes de ces pays. Mais non, voyons, jamais la Grèce ne reniera ses dettes. Et depuis trois jours, à Bruxelles, on laisse entendre que cela pourrait bien être le cas. L’Irlande, dit-on encore, ne demandera jamais une telle restructuration, le Portugal non plus. Or pratiquement tous les observateurs qui savent compter pensent qu’une banqueroute ouverte ou cachée sera inévitable.
Grossièrement, le calcul est vite fait: si le produit intérieur de ces trois pays croît, en termes nominaux, donc en euros, de 2 à 3% au grand maximum pendant ces prochaines années et que les déficits creusent des trous correspondant à 8,10 voire plus de pour-cent de ce même produit intérieur, un effet de ciseaux est garanti. Il laisse prévoir une accumulation progressive de nouvelles dettes, et l’impossibilité de s’en défaire, si importants que soient les sacrifices demandés au peuple.
La troisième étape de la crise, la sortie de ces pays de l’euro, est un tabou encore plus strict, mais attendons.
Les politiciens nationaux ou bruxellois sont donc ou des menteurs ou des incapables. C’est dur à dire, mais c’est la vérité.
Mais plaçons-nous dans la peau d’un investisseur anglo-saxon ou chinois, ou arabe, ou asiatique, ou suisse. Il constate que cette union monétaire a des difficultés, ce qui n’est pas une honte en soi. Mais les responsables ont deux tendances fâcheuses. D’une part, ils ont cassé les arrangements institutionnels de cette union monétaire, à savoir l’article 125 du Traité de Lisbonne interdisant toute aide à un membre gaspilleur, et on a abandonné la gestion étroite de la Banque centrale européenne censée ne jamais accepter des papiers de moindre qualité. Or, elle se goinfre de titres grecs, portugais et irlandais pour émettre des liquidités. D’autre part, les affirmations évoquées plus haut marchent sur des jambes courtes et trébuchent sur des faits contraires à tout moment. Ces attitudes incohérentes ne sont pas un crime, pire, ce sont des fautes, dirait Talleyrand.
Car en situation de surendettement, quand on a besoin d’investisseurs, on doit soigner la confiance. Non seulement les pays trop endettés doivent le faire, mais également les pays garants.
Comment se fier à la France ou à l’Italie, qui souscrivent d’énormes engagements en faveur de ces paquets d’aide, mais dont les responsables semblent méconnaître ou carrément obfusquer la réalité? Ces deux pays sont déficitaires dans leur commerce extérieur, ils sont hautement endettés, ils ont des déficits publics courants, des banques mal capitalisées et en situation délicate dans le cas d’une restructuration grecque, irlandaise, portugaise.



Les historiens économiques nous rapportent que les grandes crises financières se déclenchent à l’improviste, si la confiance des investisseurs se perd. Alors tout arrive en même temps – le retrait de l’argent des banques, la fuite des capitaux à l’étranger, une montée raide des taux d’intérêt, et finalement la banqueroute. L’économiste Herbert Minsky avait décrit cette dernière phase comme un système à la Madoff. Tous les pays mentionnés, et les Etats-Unis aussi, sont dans ce cas: la croissance du produit intérieur et les rentrées fiscales ne suffisent plus pour payer les intérêts de la dette publique. On paie les intérêts par de nouveaux emprunts. Et, comme chez Madoff, ces fonds nouveaux servent à dédouaner les investisseurs précédents, mais ils ne servent plus au financement du char de l’Etat.
C’est aussi dur de dire cela, mais qui peut encore le nier?
Par Beat Kappeler/le temps avril11
BILLET PRECEDENT :

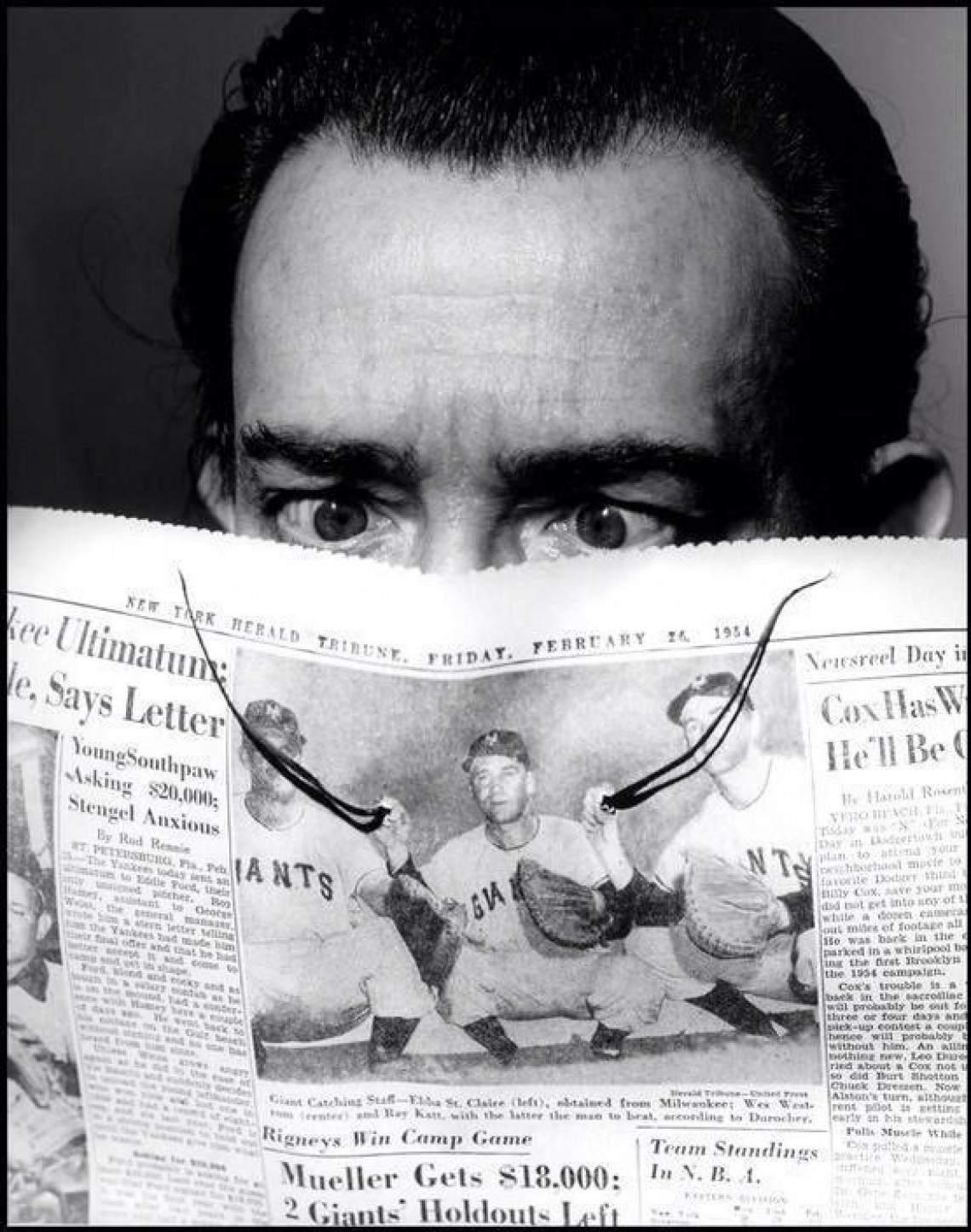









 RSS - Articles
RSS - Articles NI PUB, NI SPONSOR, NI SUBVENTION, SEULEMENT VOUS ET NOUS....SOUTENEZ CE BLOG FAITES UN DON
NI PUB, NI SPONSOR, NI SUBVENTION, SEULEMENT VOUS ET NOUS....SOUTENEZ CE BLOG FAITES UN DON















