Zone Euro : Le risque de crise bancaire n’est pas écarté
Près d’un an après le sauvetage de la Grèce, la solidité de certaines banques européenne soulève toujours des doutes

Nombre d’experts ont vu dans le sauvetage de la Grèce un moyen d’éviter une crise bancaire, plutôt qu’une preuve de la solidarité européenne. Puis, la controverse s’est étendue aux mesures d’austérité. «La pression que mettent les autres pays européens est scandaleuse. Ces Etats sont hantés par le spectre d’un défaut parce qu’ils craignent de devoir refinancer leurs banques qui sont les principales créancières de la dette grecque», expliquait Charles Wyplosz, professeur d’économie internationale à l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) à Genève, dans un entretien au Temps.
Pour beaucoup de ces sceptiques, l’idée était alors que ces établissements, principaux créditeurs des pays en difficulté, puissent se préparer à une éventuelle restructuration de la dette de certains pays et en premier lieu de la Grèce.
PLUS DE RISQUE SYSTEMIQUE EN SUIVANT :
Près d’un an après le sauvetage d’Athènes, Nicolas Véron, cofondateur du «think tank» Bruegel à Bruxelles et chercheur à l’Institut Peterson à Washington, n’hésite pas à parler de «crise larvée», même si certaines banques se sont renforcées. Pour ce spécialiste du secteur bancaire, «un an n’est de toute façon pas suffisant pour restaurer les bilans uniquement avec les marges de crédit», comme l’a illustré le Japon dans les années 1990. Dans ce contexte, «la crise bancaire pourrait durer longtemps». A son avis, «les gouvernements ont le choix entre précipiter une restructuration – ce qui pourrait être le corollaire des tests de résistance s’ils sont crédibles – et garder le secteur sous perfusion».
Pour Nicolas Véron, c’est la deuxième option qui se profile, malgré la mise en place de tests de résistance, entamés la semaine dernière et dont les résultats seront dévoilés en juin.
Plusieurs experts soulignent néanmoins une amélioration dans le paysage bancaire européen ces dernières semaines: la situation des établissements espagnols, objet de grandes inquiétudes l’an dernier, semble s’être apaisée (lire ci-dessous).
Adrien Pichoud, économiste chez Syz & Co, souligne néanmoins que la situation est plus difficile pour les banques irlandaises et portugaises, qui sont encore très dépendantes du soutien de la Banque centrale européenne (BCE) et de leur propre banque centrale, car elles peinent toujours à se financer sur le marché.
De manière générale, les banques ont-elles diminué leur exposition au risque souverain?
Difficile à évaluer, selon les économistes. Adrien Pichoud doute que ce soit le cas. «Une petite partie a toutefois pu être transférée à la BCE, soit par ses rachats d’emprunts publics, soit lorsque les banques les déposent à la BCE comme collatéraux pour obtenir de la liquidité», juge-t-il.
De son côté, Nicolas Véron juge que les tests de résistance donneront des éléments de réponse. Mais il avertit que ce risque souverain passe par plusieurs canaux: «L’exposition peut se traduire par des positions dans les pays en difficulté, mais le danger peut également venir de réaction en chaîne sur les marchés». Depuis l’an dernier, certains établissements ont sans doute cherché à vendre une partie de leurs encours de dette grecque, mais encore faut-il trouver un acheteur et être prêt à subir des pertes, poursuit-il. D’autres experts rappellent qu’une grande partie de cette exposition se trouve dans des portefeuilles où les titres sont gardés jusqu’à maturité. Il serait donc surprenant que ces positions aient drastiquement diminué.
Les statistiques de la Banque des règlements internationaux (BRI) donnent un éclairage partiel de la situation. L’exposition étrangère des banques envers la Grèce, le Portugal, l’Irlande et l’Espagne atteignait 2512 milliards de dollars (2320 milliards de francs suisses) à la fin du troisième trimestre 2010. Cela correspond à une baisse de 2,4% sur un an, hors effets de change, souligne l’institution. Au-delà de ce chiffre global, impossible d’avoir d’autres indications. Si l’exposition des banques d’un pays – l’institution ne dévoile pas le détail par banque – envers l’un des Etats dits «PIGS», a évolué, il n’est pas possible de savoir si cela est dû à une réduction des positions ou à un effet de taux de change ou de prix.
Dans ce contexte, les tests de résistance lancés par l’Autorité bancaire européenne (ABE) seront suivis avec attention. Même si les résultats de l’édition 2010, contredits quelques semaines plus tard par les difficultés des banques irlandaises, qui avaient pourtant passé l’examen, avaient semé le doute sur l’exercice. Pour Fitch, ils apparaissent «plus prometteurs», sans être «la panacée». L’agence de notation considère le scénario établi par les autorités comme assez sévère en ce qui concerne les estimations de croissance et les chocs sur les prix de l’immobilier. En revanche, ni l’hypothèse d’un défaut, ni celle d’une restructuration de la dette d’un Etat ne sont prises en compte, regrettent les analystes.
Les experts de Barclays Capital, vont plus loin: l’intérêt central de ces tests de résistance devrait être de mesurer l’impact global d’un défaut. C’est essentiel pour restaurer la confiance, soulignent-ils.
Non seulement l’hypothèse d’un défaut n’est pas prise en compte, mais les tests tablent sur des «haircuts» (perte d’une partie des créances) sensiblement inférieurs aux niveaux indiqués par les CDS (ces primes des produits d’assurance protégeant contre le non-remboursement des emprunts du gouvernement) et à ceux choisis lors du test de 2010. Par exemple, l’ABE chiffre ces pertes pour les emprunts grecs à 10 ans à 17,1%, alors que les CDS indiquent 39,1% et que le test de l’an dernier tablait sur 23,1%.
Les doutes sur la santé du secteur bancaire européen risquent donc d’être présents pour quelque temps encore.
L’Espagne rassure/La situation des banques semble s’améliorer, même si cela est passé inaperçu
«Les caisses d’épargne espagnoles (Cajas) ont subi une cure d’amaigrissement importante. Le nombre d’entre elles est passé de 45 à 17 via la mise en place de douze processus d’intégration», souligne Natixis dans une étude. La banque française rappelle que le gouvernement a également demandé à ces établissements de se recapitaliser à hauteur de 14,1 milliards d’euros le 23 mars dernier.
Pour Adrien Pichoud, économiste chez Syz & Co, «le gouvernement a donné des gages et pris des mesures qui ont déjà largement réduit le risque de crise bancaire dans le pays». Cela a permis de «soulager les marchés, même si la situation n’est pas encore flamboyante».
En témoigne la décision de Moody’s fin mars d’abaisser la notation de 30 banques espagnoles d’un ou plusieurs crans et estimé que les perspectives restaient faibles et qu’aucune amélioration sensible n’était à attendre dans un avenir proche. Une annonce qui a fait suite à la dégradation de la note souveraine du pays début mars.
Les marchés semblent penser autrement. Alors que l’attention est restée focalisée sur le Portugal, dont les taux ont atteint des records, l’Espagne a suivi un autre chemin depuis le début de l’année. L’écart de rendement entre les emprunts souverains allemands et espagnols s’est en effet sensiblement resserré, souligne Ursina Kubli, économiste chez Sarasin
Par Mathilde Farine/le temps avril11
EN COMPLEMENT : UBS et Credit Suisse, plus qu’une simple histoire de «Cocos»
Oswald Grübel ne cesse de critiquer les mesures pour répondre au risque posé par les banques de taille systémique. Il a de bonnes raisons pour le faire, mais ce ne sont pas celles qu’il invoque
C’est une fausse polémique. Depuis des semaines, Oswald Grübel ne manque pas une occasion de tirer à boulets rouges sur les «Coco bonds». Ces obligations figurent parmi les outils permettant aux banques dites trop grandes pour faire faillite de reconstituer leurs fonds propres en cas de coup dur (elles sont alors automatiquement converties en actions). Le directeur général d’UBS les trouve «dangereuses». Il l’a écrit la semaine passée au Conseil fédéral, au terme de la consultation de son projet pour résoudre le problème communément appelé du «too big to fail».
La fausse polémique a enflé parce que, dans le même temps, Credit Suisse a en quelque sorte déclaré sa flamme pour ces obligations Coco. La rivale d’UBS en a émis pour 6 milliards de francs.
Le débat a pourtant été lancé sur de mauvaises bases car, en réalité, rien n’oblige les banques à utiliser ces obligations-là. Mieux, l’idée d’Oswald Grübel de pouvoir émettre des obligations, appelons-les les «Grübel bonds», qui perdraient la moitié de leur valeur en cas de coup dur figure dans le projet du Conseil fédéral.
Reprenons.
Pour éviter que le contribuable ne vienne une nouvelle fois sauver une banque dont la disparition mettrait en péril le système financier, et donc économique, suisse, les autorités demandent à ces établissements d’augmenter leurs réserves. Une commission d’experts, à laquelle participaient les banquiers, a formulé plusieurs propositions, reprises en bonne partie par le Conseil fédéral. Ce dernier doit bientôt transmettre un message au parlement, qui devrait s’en emparer après l’été.
Les fonds propres devraient en particulier grimper à 19% des actifs pondérés du risque, bien au-delà des 10,5% exigés par les accords internationaux de Bâle III. Pour y parvenir, et pour simplifier, les banques peuvent émettre des actions, des Cocos, ou des obligations avec un amortissement forcé (les «Grübel bonds»).
Oswald Grübel juge les Cocos trop coûteuses et redoute les effets pour les actionnaires, et le cours de bourse. Celles déjà émises, par Credit Suisse et d’autres, offrent un rendement annuel d’au moins 9%, bien plus que les quelque 2% des obligations de la Confédération. Autre critique de l’Allemand, la dilution que les actionnaires subiraient en cas de conversion des Cocos en actions.
Le premier argument du coût n’est pas convaincant. Car rien ne dit que les «Grübel bonds» seront moins coûteux. Car leur détenteur risque de perdre la moitié de sa mise. Avec les Cocos, l’investisseur se retrouve au pire avec des actions en main, et l’occasion de se refaire à terme une fois la banque redressée. En outre, si la moitié seulement de l’obligation est effacée, ce qui dégage donc une sorte de gain pour la banque, il faut en émettre deux fois plus que de Cocos pour couvrir le même niveau de fonds propres.
L’argument de la dilution paraît lui plus recevable. Les «Grübel bonds» en tout cas la limitent. De ce point de vue, on peut se demander si ces obligations à amortissement automatique n’encourageront les actionnaires à prendre des risques, qui seraient payés en cas de problème par les créanciers.
Enfin, l’idée que le financement des fonds propres par des Cocos ou par des «Grübel bonds» ou même par une émission d’action aurait une influence différenciée sur la valorisation d’UBS s’oppose à un théorème bien connu, celui de Modigliani et Miller. Les deux Prix Nobel 1985 ont démontré que la valeur d’une entreprise ne dépend pas de la façon dont elle se finance.
La vraie raison de la colère d’Oswald Grübel tient sans doute dans la structure actuelle des fonds propres de sa banque. Sa concurrente Credit Suisse compte beaucoup de capital dit hybride, qui n’est plus éligible dans les règles en préparation. Le numéro deux suisse doit donc les remplacer. Or ces fonds sont rémunérés à un niveau proche de celui des Cocos. L’opération a donc peu d’incidence financière. Cela pourrait expliquer la rapidité du mouvement de la banque de Brady Dougan. Qui, au passage, se fait bien voir par des autorités dont l’intervention future pour régler le différend fiscal avec Washington pourrait être précieuse.
A l’inverse, UBS a mieux négocié ses capitaux hybrides. Leur rémunération se situe entre 4 et 7,25%, rappelait Bloomberg la semaine passée. Passer au tarif coco coûtera donc cher, effectivement. Mais l’addition sera salée de toute façon pour remplir les nouvelles exigences.
La vivacité du débat en Suisse s’explique aussi par l’avancée de la réforme, en comparaison internationale. Cet argument est d’ailleurs servi par ceux qui s’y opposent, pour éviter un désavantage compétitif. On ne peut s’empêcher d’y lire une certaine dose de mauvaise foi. Car ces mêmes voix critiques ont souscrit au rapport de la commission d’experts, dans lequel elles ont reconnu la spécificité de la Suisse (où, cas unique au monde, le bilan des deux grandes banques pèse plusieurs fois le produit intérieur brut). Une spécificité qui impose des règles plus strictes qu’à l’étranger.
Sans compter deux autres choses. D’une part, il faut encore démontrer que ces règles ne donneront pas au final un avantage de solidité à la place suisse. D’autre part, les règles se durcissent tout de même en dehors de nos frontières. Aux Etats-Unis, les banques ne peuvent plus librement choisir leurs activités. En Europe, les clients des banques bénéficient d’une protection toujours supérieure à ce qu’elle est ici.
Enfin, le débat subit un biais politicien court-termiste. Quel parti souhaite, en cette année d’élection, donner une victoire à Eveline Widmer-Schlumpf, en charge du dossier au Conseil fédéral, et dont le siège est menacé vu sa faible assise politique… Une façon de contourner cet obstacle, et d’éviter que les leçons de la crise historique d’UBS ne soient pas tirées, serait de coller aux solutions en quelque sorte apolitiques de la commission d’experts. Sans fausse polémique.
Par Frédéric Lelièvre Le Temps avril

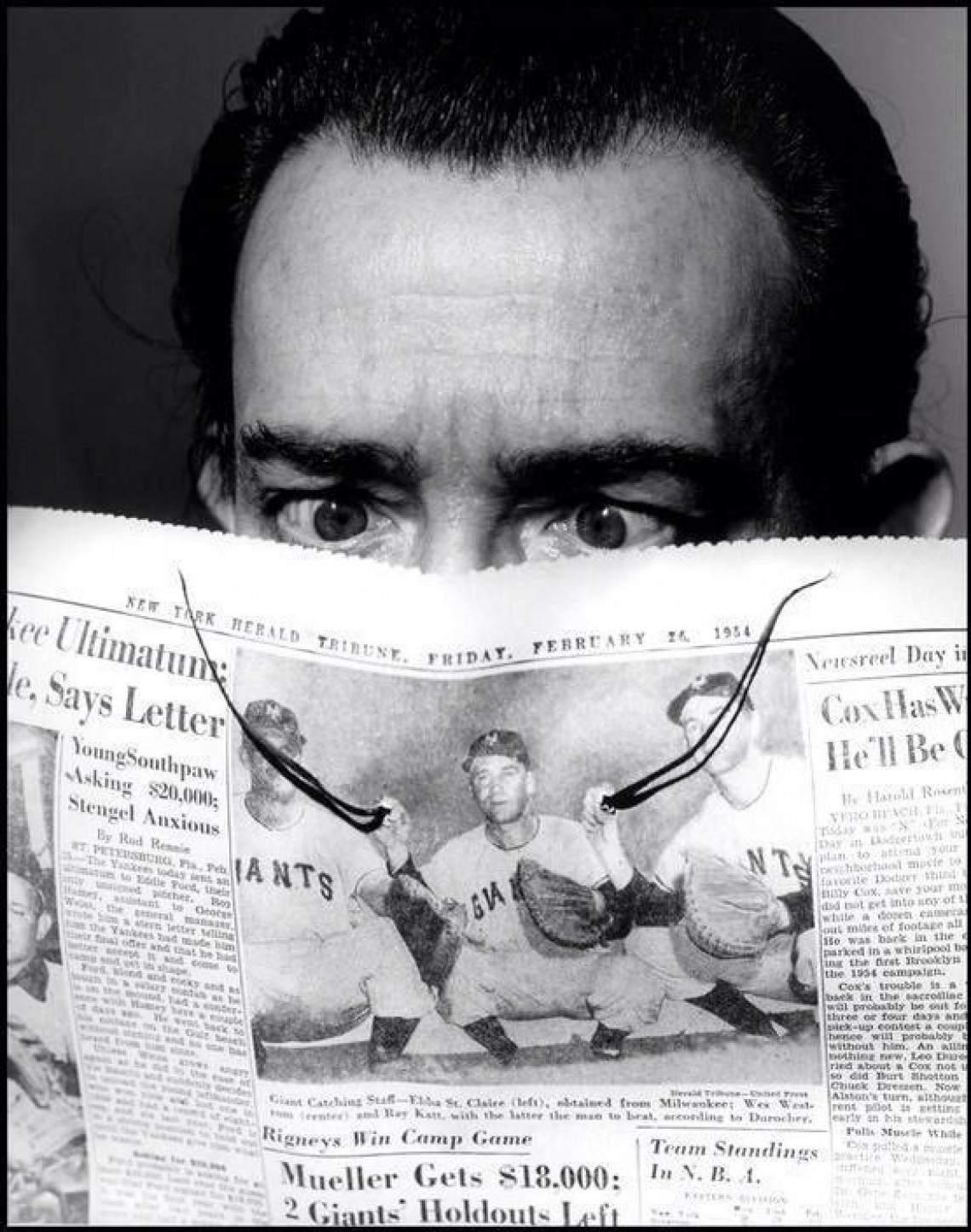











 RSS - Articles
RSS - Articles NI PUB, NI SPONSOR, NI SUBVENTION, SEULEMENT VOUS ET NOUS....SOUTENEZ CE BLOG FAITES UN DON
NI PUB, NI SPONSOR, NI SUBVENTION, SEULEMENT VOUS ET NOUS....SOUTENEZ CE BLOG FAITES UN DON















